Promesse d’avenir ou mirage technologique ?
L’hydrogène est une molécule aux multiples vertus : c’est à la fois une matière première industrielle et un vecteur énergétique clé pour se substituer aux énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon). Historiquement, sa production reposait principalement sur le pétrole et le gaz naturel, générant alors d’importantes émissions de CO2. Remplacer cet hydrogène « carboné » ou «hydrogène gris » par des alternatives plus propres est donc une étape fondamentale vers la décarbonation.
Depuis une dizaine d’année, l’hydrogène « décarboné » se développe sous deux formes principales : l’hydrogène « vert » et l’hydrogène « bleu ».
L’hydrogène vert est majoritairement produit par électrolyse de l’eau. Ce processus, alimenté par des sources d’énergie renouvelables, permet de scinder les molécules d’eau en hydrogène et en oxygène, sans émissions de carbone.
L’hydrogène bleu est issue= de ressources fossiles (pétrole ou gaz) mais ses émissions de CO2 sont capturées, ré-utilisées ou stockées à long terme.
L’hydrogène décarboné : un levier essentiel pour la décarbonation
L’hydrogène est donc utilisé comme matière première dans les industries fortement émettrices de CO2, telles que le raffinage du pétrole, la production d’acier, d’engrais ou de produits chimiques. Il peut également remplacer le gaz naturel dans les fours industriels, moyennant certaines adaptations, et ainsi permettre de réduire les émissions du secteur cimentier ou sidérurgique.
Il est aussi utilisé pour décarboner le secteur des transports. Sur la route, on le retrouve dans les véhicules électriques à pile à combustible ou dans les moteurs à combustion d’hydrogène. Pour le transport maritime ou aérien, des dérivés de l’hydrogène comme l’ammoniac, le méthanol et le carburant d’aviation durable (SAF) sont utilisés en remplacement des carburants pétroliers.
Ce fort potentiel a engendré une vague d’annonces de projets de production d’hydrogène vert ou bleu à l’échelle mondiale depuis 2020.
L’essor mondial des projets hydrogène
Pour suivre cette dynamique, Enerdata a développé un outil recensant tous les projets d’hydrogène décarboné de grande échelle. Actuellement, plus de 830 projets sont répertoriés à travers le monde, chacun doté d’une puissance d’électrolyseur d’au moins 100 MW. Ils pourraient ainsi produire environ 200 millions de tonnes d’hydrogène décarboné, ainsi que 470 millions de tonnes de dérivés propres (ammoniac, méthanol, méthane et kérosène).
La consommation d’électricité représentant environ 70 % des coûts de production, les régions riches en ressources renouvelables abordables ont un avantage significatif (Égypte, Australie, Chili et Maroc suivis des États-Unis, de la Chine, de l’Inde et de l’Europe).
Progrès actuels et défis de l’hydrogène décarboné
Après un pic d’annonces entre 2020 et 2023, l’année 2024 a ramené à la réalité : de nombreux projets peinent à dépasser la phase initiale ou l’étude de faisabilité et n’atteignent pas la décision d’investissement finale. Certains projets, jugés irréalistes (comme « Spirit of Scotia » au Canada - 43 millions tonnes par an ou « Western Green Energy Hub » en Australie - 3 millions tonnes par an), ont même été annulés. Beaucoup d’autres projets ne trouvent pas même d’acheteurs pour l’hydrogène qu’ils produiraient.
Enerdata estime que seulement 7 à 9 % des projets annoncés sont en phase avancée, soit un maximum de 75 projets sur les 830 recensés ! Ce pourcentage reste globalement constant, y compris en Europe et en France, avec de légères variations.
La France a annoncé plus de 28 grands projets d’hydrogène décarboné, avec un potentiel de production de plus de 1,4 million de tonnes dans les 10 à 20 prochaines années, contrastant avec la consommation actuelle d’environ 0,6 million de tonnes (majoritairement grise). Cependant, seuls 3 projets, totalisant une capacité de production combinée de 0,1 million de tonnes d’hydrogène décarboné, sont en phase avancée. A noter également la récente mise à jour de la stratégie hydrogène par le gouvernement français, révisant l’objectif à 0,5 million de tonnes d’ici 2030.
Malgré ces défis, certains projets progressent grâce à des accords d’achat et des décisions d’investissement finales. Par exemple, TotalEnergies s’est engagé avec Air Liquide et RWE pour fournir de l’hydrogène décarboné à ses raffineries européennes. Verso Energy, un développeur français, fait progresser plusieurs projets d’hydrogène vert pour produire du kérosène décarboné (SAF) en France et en Finlande. Le projet « Scatec Green Ammonia » en Égypte est le premier projet d’importation d’hydrogène vers l’Europe à obtenir un contrat d’achat et des subventions Européennes.
Ces succès partagent de caractéristiques communes. Afin de combler l’écart de prix entre l’hydrogène gris et l’hydrogène vert, les développeurs et les acheteurs s’appuient sur une combinaison de subventions aussi bien du côté de l’offre que de la demande, incluant les régimes de soutien locaux et régionaux, mesures essentielles pour assurer leur viabilité économique. Les politiques publiques jouent un rôle crucial dans la stimulation de la demande, en utilisant à la fois les incitations et les pressions règlementaires. Par exemple, les réglementations européennes fixent des seuils d’émission pour les raffineries et imposent l’utilisation de SAF dans le secteur aérien. La tarification du carbone renforce également l’adoption de l’hydrogène décarboné.
Dans certains cas, les acheteurs d’hydrogène vert répercutent une partie des coûts supplémentaires sur les consommateurs finaux. Par exemple, le coût marginal de l’acier vert dans la production de véhicules électriques est souvent accepté par les consommateurs, prêts à payer un supplément pour un produit moins carboné.
Politiques et géopolitique : des catalyseurs pour l’hydrogène
La transition énergétique et les bouleversements géopolitiques (notamment, la guerre en Ukraine) ont exacerbé les préoccupations liées à la sécurité énergétique et aux risques d’approvisionnement. Cela a entraîné des changements politiques majeurs, des législations préférentielles et des mécanismes de soutien favorisant les sources d’énergie plus propres, locales et diversifiées.
Des cadres juridiques comme la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA), ainsi que la directive européenne RED III et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) soutiennent directement le développement et le déploiement de l’hydrogène propre. La stratégie européenne sur l’hydrogène et l’initiative RePowerEU ont fixé des objectifs ambitieux : produire 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable localement et en importer 10 millions de tonnes supplémentaires d’ici 2030.
L’hydrogène vert, classé comme un carburant renouvelable d’origine non biologique (RFNBO) par l’Union Européenne, est éligible à diverses incitations financières (Fonds européen pour l’innovation, Banque européenne pour l’hydrogène). De plus, les industries utilisant ces carburants peuvent atteindre leurs objectifs de réduction d’émissions tout en évitant les pénalités fiscales liées aux émissions de CO2, comme c’est le cas pour les raffineries.
Surmonter les obstacles à l’adoption de l’hydrogène vert
Malgré l’élan et le soutien public considérable, l’industrie de l’hydrogène décarboné fait face à d’importants les défis financiers, technologiques et techniques. Le principal obstacle reste son coût de production élevé (environ 6 €/kg en Europe) comparé à l’hydrogène gris traditionnel (environ 2 €/kg).
Au- delà du coût, la complexité des projets complexes est accrue par la nécessité de développer des fermes solaires et éoliennes supplémentaires, de sécurise l’approvisionnement en eau, d’assurer une proximité entre production et consommation pour limiter le transport, et de respecter des normes environnementales, sociales et sécuritaires strictes.
En Europe, pour conserver son label « vert » en tant que RFNBO, les projets doivent respecter trois principes stricts : l’additionnalité, la localisation et la corrélation temporelle entre la production d’électricité renouvelable et celle de l’hydrogène vert. La synchronisation et la documentation rigoureuses tout au long du processus augmentent encore les coûts et la complexité.
Pour les projets visant l’exportation internationale, le transport de l’hydrogène est un défi majeur. Sa faible densité volumétrique nécessite qu’il soit comprimé à très haute pression, liquéfié ou converti en vecteurs liquides plus facilement transportables (ammoniac ou méthanol). Ces processus sont énergivores et augmentent la complexité technique ainsi que les investissements nécessaires.
L’hydrogène décarboné : des perspectives réalistes pour un avenir durable
L’industrie de l’hydrogène décarboné est un secteur émergent qui suit une courbe de maturation technologique typique. Ce développement impliquera un processus d’apprentissage, la sélection des projets les plus solides, des revers et des succès, ainsi que des leçons précieuses. Ces défis sont inhérents à toute nouvelle technologie et ne devraient pas freiner l’investissement dans ce vecteur énergétique prometteur. L’hydrogène est, et continuera d’être, une solution viable pour décarboner de nombreuses industries.
Cependant, ce potentiel doit être évalué en tenant compte des opportunités économiques, des limites techniques et des alternatives disponibles. L’hydrogène ne doit pas être perçu comme la solution unique aux émissions de carbone, mais plutôt comme une option parmi d’autres, à évaluer au cas par cas. Le rapport entre la réduction des émissions et le coût associé doit guider les investissements et les subventions publics.
Alors que le transport routier peut être largement décarboné par les véhicules électriques à batterie, l’hydrogène est plus adapté aux applications de transport lourd. Des investissements et des innovations continues sont nécessaires dans les moteurs marins utilisant l’ammoniac et le méthanol dérivés de l’hydrogène vert. Le secteur du transport maritime, fortement émetteur de CO2, manque actuellement d’alternatives viables aux combustibles fossiles.
La priorité devrait également être accordée au développement de clusters industriels avec une demande suffisante en hydrogène, en lien avec les infrastructures associées (comme les conduites de gaz réaffectées au transport de l’hydrogène) pour améliorer l’efficacité. La simplification des procédures d’autorisation pour les projets d’énergies renouvelables et la réduction des risques liés aux investissements limiteront les coûts de développement et accéléreront le déploiement de l’hydrogène décarboné.
La chaîne de valeur industrielle française a un rôle important à jouer dans l’écosystème de l’hydrogène, tant en Europe qu’à l’international. Elle est parmi les plus développées au monde et inclut des fabricants d’équipements, des développeurs de projets et d’autres acteurs créant de la valeur, contribuant ainsi au leadership industriel français dans diverses régions du monde – une tendance positive qui mérite d’être reconnue et soutenue.
 Ahmed ABBAS
Ahmed ABBAS
Analyste Sénior Clean Technologies chez Enerdata
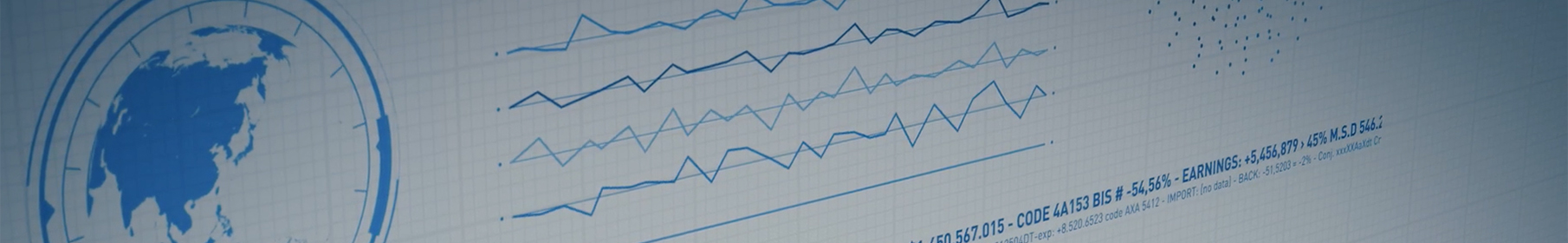 Bases de données énergie - climat
Bases de données énergie - climat Analyse du Marché
Analyse du Marché